Chapitre 1 - La rencontre (extrait)
Je ne sais pas si c’est le moment de raconter comment j’ai vécu. Mais puisque vous me le demandez…
Je ne suis pas sûr de savoir par où commencer.
Devrais-je me repentir, commencer à négocier comme quand je négociais un taux d’intérêt ?
Ou alors peut-être devrais-je commencer par Clémence.
Oui, Clémence Dubreuil. Son nom résonne encore en moi avec cette clarté douloureuse des choses qu’on a perdues avant même de les avoir comprises. Elle est arrivée un matin de septembre dans l’agence de la rue de Bourgogne, avec ce regard – comment dire ? – intact. C’est le mot. Intact. Comme si la vie ne l’avait pas encore abîmée.
Mais je devrais revenir en arrière. Avant Orléans. Avant la rue de Bourgogne.
Avant que tout ne commence vraiment.
Elle venait de terminer des études brillantes en finance. Major de sa promotion. Elle avait réussi, par son tempérament, à décrocher un rendez-vous avec le plus gros cabinet de courtage en crédit de la région Centre. Pas n’importe quel cabinet. Centre Capital Courtage. Le mastodonte. Celui qui brassait des millions d’euros de crédits chaque année.
Elle postulait au poste de courtière à l’agence d’Orléans.
Et pour obtenir ce poste, il fallait d’abord passer par moi.
Elle se tenait face à moi, Tiago Almeida, le directeur général basé à Tours, vivant à Tours. Celui qui avait construit son empire en partant de rien – fils d’émigrés portugais qui savaient à peine lire, j’aimais le rappeler quand ça m’arrangeait.
Je gérais plusieurs agences dans la région Centre. Tours, Blois, Orléans, Bourges et Chartres. Un petit royaume discret dont je tirais les ficelles depuis mon bureau du troisième étage de l’immeuble des Halles, place Gaston-Pailhou, avec vue plongeante sur la Loire et les ponts de Tours. De ma fenêtre, je voyais le fleuve couler, indifférent, et les touristes se presser vers la cathédrale Saint-Gatien. Un bureau d’angle. Parquet d’origine. Moulures. Le genre d’endroit qui vous rappelle constamment que vous avez réussi.
Et elle était là, assise en face de moi. Dans ce bureau de Tours. Venue d’Orléans pour me convaincre.
Les mains posées sagement sur ses genoux. Son tailleur – trop grand, probablement emprunté – flottait légèrement sur ses épaules. Mais elle ne tremblait pas.
Elle aurait dû trembler.
J’étais habitué à voir trembler les candidats dans ce bureau. La vue sur la Loire, les diplômes encadrés au mur, la réputation qui me précédait. Tout était calculé pour intimider. Pour trier. Pour savoir qui avait les reins assez solides pour survivre dans ce milieu.
Mais elle me regardait droit dans les yeux.
J’ai posé son CV sur le bureau sans le regarder. Je connaissais déjà son parcours par cœur. Ce qui m’intéressait, c’était ce qu’on ne peut pas mettre dans un CV.
— Pourquoi le courtage en crédit ?
Elle n’a pas hésité. Pas un battement de cil.
— Parce que le crédit, c’est le nerf de l’économie réelle. Les marchés financiers, c’est abstrait, des chiffres qui dansent sur des écrans. Mais un prêt immobilier, un financement d’entreprise, ça change une vie. Ça construit quelque chose de concret. Vous en savez quelque chose, non ?
Ce « non » en fin de phrase. Cette façon de me renvoyer la balle. Peu de candidats osaient.
J’ai souri malgré moi.
— Vous faites vos devoirs avant un entretien, à ce que je vois.
— Toujours. J’ai lu votre parcours. Fils d’émigrés portugais. Bac avec mention. École de commerce à Tours. Premier poste chez BNP, puis Crédit Agricole, avant de monter avec votre associé Centre Capital Courtage. Vous êtes passé de stagiaire en banque à Directeur général du plus gros cabinet de courtage en dix ans.
Elle récitait sans notes. Elle avait retenu.
— Et alors, lui disais-je ?
— Je sais aussi que dans votre modèle, les meilleurs courtiers peuvent devenir associés du cabinet. C’est mon objectif. Et je me donnerai les moyens pour y parvenir.
Là, j’ai vraiment souri.
Associée. Elle venait de sortir d’école, elle postulait pour un premier poste, et elle parlait déjà d’association.
— Comment ? j’ai simplement demandé.
— Comment quoi ?
— Comment comptez-vous y parvenir ? Parce que des candidats qui me promettent monts et merveilles, j’en vois trois par semaine. Tous brillants sur le papier. Tous motivés. Tous persuadés d’être exceptionnels. Et la moitié ne tient pas six mois.
Elle n’a pas cillé.
— Je connais Orléans. Pas juste la géographie. Les gens. Les réseaux. Pendant mes études, j’ai démarché des entreprises pour des projets associatifs. J’ai appris à identifier qui décide, qui influence, qui a du patrimoine. J’étais vice-présidente de l’association sportive universitaire – handball féminin. Ça m’a mis en contact avec des chefs d’entreprise sponsors, des commerçants, des élus locaux. J’ai aussi participé à une junior entreprise qui faisait des études de marché pour des PME orléanaises. J’ai vu l’intérieur des entreprises. Leurs besoins. Leurs cycles de développement.
Elle parlait vite, avec précision. Pas pour se vanter. Pour démontrer.
J’ai croisé les bras. Écouté attentivement.
— Et puis, elle a continué, j’ai un autre avantage.
— Lequel ?
— Je ne crains pas d’échouer. Parce que l’échec, pour moi, ce n’est pas de perdre ce poste. L’échec, c’est de ne jamais avoir essayé.
Voilà.
C’était ça.
Cette phrase-là.
J’avais développé, au fil des années, une capacité assez rare dans ce métier. Une sorte de sixième sens. Je pouvais ressentir les compétences. Pas les diplômes, pas les beaux discours. Les compétences réelles. Cette alchimie entre l’intelligence, le tempérament et l’ambition.
Et surtout, je pouvais me projeter. Voir, en trente secondes, ce qu’un candidat pourrait devenir dans deux ans, cinq ans, dix ans.
Certains avaient du potentiel mais manquaient de discipline. D’autres avaient la technique mais pas le feu. D’autres encore avaient tout, sauf cette chose insaisissable qu’on appelle la présence.
Clémence avait tout.
Je le voyais. Je le sentais.
Cette façon qu’elle avait de tenir son regard sans arrogance mais sans faiblesse. Cette capacité à parler de ses ambitions sans enjoliver, sans chercher à plaire. Cette intelligence dans ses réponses, qui ne récitait pas un manuel mais analysait, synthétisait, projetait.
Elle n’était pas juste brillante. Elle était redoutable.
Et je savais – je savais déjà – qu’elle allait réussir.
— Bien, j’ai dit en refermant le dossier. Je vous prends.
Elle a écarquillé les yeux. Une fraction de seconde. La première trace de surprise depuis le début de l’entretien.
— Vraiment ?
— Période d’essai de trois mois. Salaire fixe modeste, variable intéressant sur vos dossiers. Vous commencez lundi prochain, 9 heures, agence de la rue de Bourgogne. Le manager s’appelle Julien Moreau. Il est bon. Exigeant. Il va vous former.
J’ai griffonné l’adresse et le nom sur une carte.
— Ne le décevez pas. Et surtout, ne me décevez pas.
Elle s’est levée. A pris la carte. Et là, elle a fait quelque chose d’inattendu.
Elle a tendu la main.
Pas pour me remercier. Pas pour sceller un accord professionnel.
Pour me regarder dans les yeux, une dernière fois, et me dire :
— Je ne vous décevrai pas.
Nos mains se sont serrées.
Ferme. Brève.
Et quand elle est sortie, j’ai regardé la porte se refermer.
L’histoire commençait bien. J’étais ravi de ce recrutement.
Une bonne action, n’est-ce pas ? Je pourrais la porter à mon crédit, non ?
Un acte généreux, qu’en pensez-vous ?
Mais je vois que ce n’est pas satisfaisant. Vous ne semblez pas convaincu. Vous voulez en savoir plus, n’est-ce pas ? Vous voulez comprendre la suite ?
Très bien. Allons-y.
Après tout, il ne me reste plus que ça à faire ici. Raconter. Me souvenir. Et ensuite…Vous déciderez.
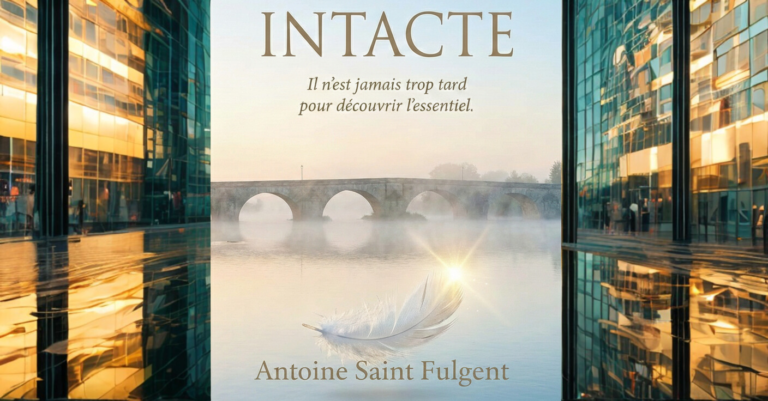
Chapitre 2 - Helena (extrait)
Mais avant de poursuivre, je vais vous raconter Helena.
Pas parce que vous me le demandez. Parce que je dois le faire. Parce que sans Helena, vous ne comprendrez rien. Ni ce que j’ai fait à Clémence. Ni pourquoi je suis ici, devant vous, à tenter de démêler les fils d’une vie que j’ai si mal tissée.
Helena.
Son nom, déjà, portait quelque chose d’ancien. De grec. De tragique, peut-être.
C’était en deuxième année d’école de commerce. Tours. L’automne.
Je vivais dans une résidence étudiante sans charme, rue du Petit-Pré. Une chambre de douze mètres carrés avec un lavabo, un lit étroit, une table qui servait de bureau et de table à manger. Les murs étaient d’un beige institutionnel que personne n’avait jamais songé à repeindre.
Je n’avais pas d’amis. Pas vraiment. Des camarades de promotion avec qui je travaillais sur des projets de groupe, des visages que je croisais en amphithéâtre, des noms que j’oubliais sitôt les examens passés.
Sauf Florence.
Florence Marchand. Ma seule véritable camarade. Nous nous étions rencontrés en première année, lors d’un cours de comptabilité analytique où je n’avais rien compris. J’avais été absent la semaine précédente — une grippe qui m’avait cloué au lit — et je me noyais dans les écritures de régularisation.
Elle s’était penchée vers moi.
— Tu veux que je t’explique ? J’ai des notes complètes.
C’est ainsi que tout avait commencé. Florence était brillante. Vraiment brillante. Pas seulement intelligente — organisée, méthodique, généreuse de son temps. Elle prenait des notes impeccables, qu’elle photocopiait pour moi quand je manquais un cours. Nous travaillions ensemble à la bibliothèque, révisions nos examens côte à côte, partagions nos angoisses avant les partiels.
Je savais que Florence aimait les filles. Elle ne l’avait jamais dit explicitement, mais certaines choses ne se disent pas — elles se comprennent. La façon dont elle regardait certaines femmes. Son silence quand les autres parlaient de leurs conquêtes masculines. Cette distance qu’elle maintenait avec les garçons qui s’intéressaient à elle.
Cela ne changeait rien pour moi. Florence était mon amie. Ma seule amie, peut-être. Et dans cette résidence étudiante où je me sentais perpétuellement étranger, sa présence était un ancrage.
Un soir d’octobre, elle a frappé à ma porte.
— Il y a une fête à l’étage d’Helena ce soir. Tu viens ?
— Helena ?
— Helena Carvalho. Une copine. Elle est en économie. Tu vas l’adorer, elle est… spéciale.
Je n’avais pas envie d’aller à une fête. Je n’avais jamais envie d’aller aux fêtes. Mais Florence insistait rarement, et quand elle le faisait, c’est qu’elle avait ses raisons.
— D’accord.
Elle a souri. Ce sourire complice qu’elle avait parfois.
— Tu me remercieras.
Je ne savais pas à quel point elle avait raison.
La fête était comme toutes les fêtes d’étage. Une vingtaine d’étudiants entassés dans une chambre à peine plus grande que la mienne. De la bière tiède. De la musique trop forte. Des conversations que je n’écoutais pas.
Florence m’avait abandonné dès notre arrivée, happée par un groupe de filles que je ne connaissais pas. Je m’étais adossé au mur, près de la fenêtre, comptant mentalement les minutes avant de pouvoir partir sans paraître impoli.
J’étais sur le point de m’éclipser quand quelqu’un a baissé le volume.
— Helena, tu nous chantes quelque chose ?
J’ai levé les yeux.
Et je l’ai vue.
Blonde. Les yeux bleus. Une anomalie, pour une Portugaise. Elle ressemblait à ces actrices américaines des années soixante-dix — Meryl Streep jeune, peut-être, avec cette même luminosité tranquille, cette même impression de grâce naturelle.
Elle a secoué la tête, gênée.
— Non, non… Je ne peux pas comme ça…
Mais les autres insistaient. Florence, surtout, qui lui avait pris la main.
— Allez, Helena. Pour moi.
Et moi, je ne pouvais plus détacher mon regard d’elle.
Elle a fini par céder.
Elle s’est assise sur le rebord du lit. A fermé les yeux un instant. Et quand elle les a rouverts, quelque chose avait changé dans la pièce. L’air était devenu plus dense. Plus grave.
Elle a chanté Abandono.
Amália Rodrigues. Le fado de l’abandon. De l’amour perdu.
« Deixaste um vazio na minha vida… »
Tu as laissé un vide dans ma vie.
Sa voix.
Comment décrire sa voix ?
Elle ne chantait pas. Elle priait. Elle saignait. Chaque note portait une blessure que je ne comprenais pas mais que je ressentais dans ma chair.
Je crois que mon âme a frissonné. Un frissonnement divin, même si je n’étais pas croyant.
Mon cœur voulait sortir de ma cage thoracique. Littéralement. Je sentais les battements contre mes côtes, violents, désordonnés, comme un animal pris au piège.
Je ne savais pas ce qui m’arrivait.
Moi qui étais si distant. Si imperméable. Moi qui avais traversé vingt ans sans jamais rien ressentir de cette intensité.
Quand elle a terminé, il y a eu un silence. Puis des applaudissements. Elle a souri, embarrassée, et la musique a repris.
Mais moi, je n’entendais plus rien.
Je la regardais.
